Au sud du Maroc, à seulement quarante minutes d’Agadir, Taghazout et Tamraght étaient
autrefois de petits villages de pêcheurs amazighs. On y vivait simplement, au rythme de la
mer, de la pêche et des traditions locales.
Dans les années 1960 et 1970, de jeunes hippies américains découvrent ces côtes
sauvages et leurs vagues spectaculaires. Séduits, ils s’installent, apportant avec eux la
culture surf. Rapidement, les habitants s’approprient cette pratique, mais la vie reste
paisible.
À partir des années 1980 et 1990, le paysage change. Le tourisme prend racine. Peu à peu
apparaissent surf-shops, coffee shops, écoles de yoga et skate parks. Le charme brut des
villages commence à s’estomper, remplacé par une atmosphère plus commerciale.
Quand Instagram accélère la gentrification
Aujourd’hui, Taghazout et Tamraght connaissent une nouvelle phase de transformation :
celle de l’insta-gentrification, un phénomène évoqué par ARTE dans le documentaire Au
Maroc, surfeurs et artistes face à l’insta-gentrification.
À l’ère des réseaux sociaux, les destinations touristiques ne sont plus seulement des lieux à
visiter, mais des décors à photographier. Les voyageurs viennent chercher des spots «
instagrammables », et les commerces s’adaptent à cette demande : coffee shops, espaces
de coworking, rooftops… Mais cette quête de l’image parfaite a un prix. L’authenticité
s’efface. À Imsouane, village voisin, des maisons traditionnelles ont été détruites pour
laisser place à des cafés surf standardisés.
À Taghazout, le gigantesque projet Taghazout Bay a vu surgir
hôtels de luxe et golfs. Une modernisation qui séduit les investisseurs et
attire les foules, mais qui éloigne ces villages de leur âme amazighe
Un développement en demi-teinte
Bien sûr, tout n’est pas négatif. Le tourisme a apporté des emplois, de nouvelles routes, des
infrastructures plus modernes. Des événements comme la Taghazout Surf Expo tentent
même de mettre en avant la culture locale, qu’il s’agisse de l’artisanat, de la cuisine ou des
traditions berbères.Mais les inquiétudes grandissent :
● une pollution accrue et une gestion des déchets insuffisante,
● une esthétique de plus en plus uniformisée, qui gomme la singularité des villages.
● des spots de surf saturés par les écoles touristiques.
Les artistes comme gardiens de l’âme
Face à cette uniformisation, des artistes locaux et internationaux réagissent. Dans les
ruelles, sur les murs ou même sur les rochers, fresques et œuvres de street art rappellent
les racines amazighes et redonnent de la couleur aux villages. Une manière poétique de
résister à l’uniformisation imposée par Instagram.
Par Léa Tirveilliot
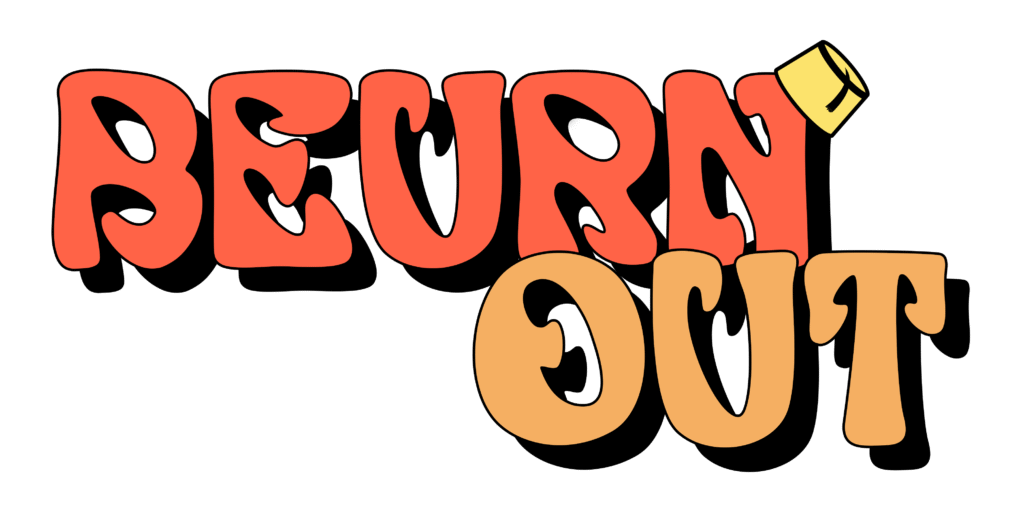
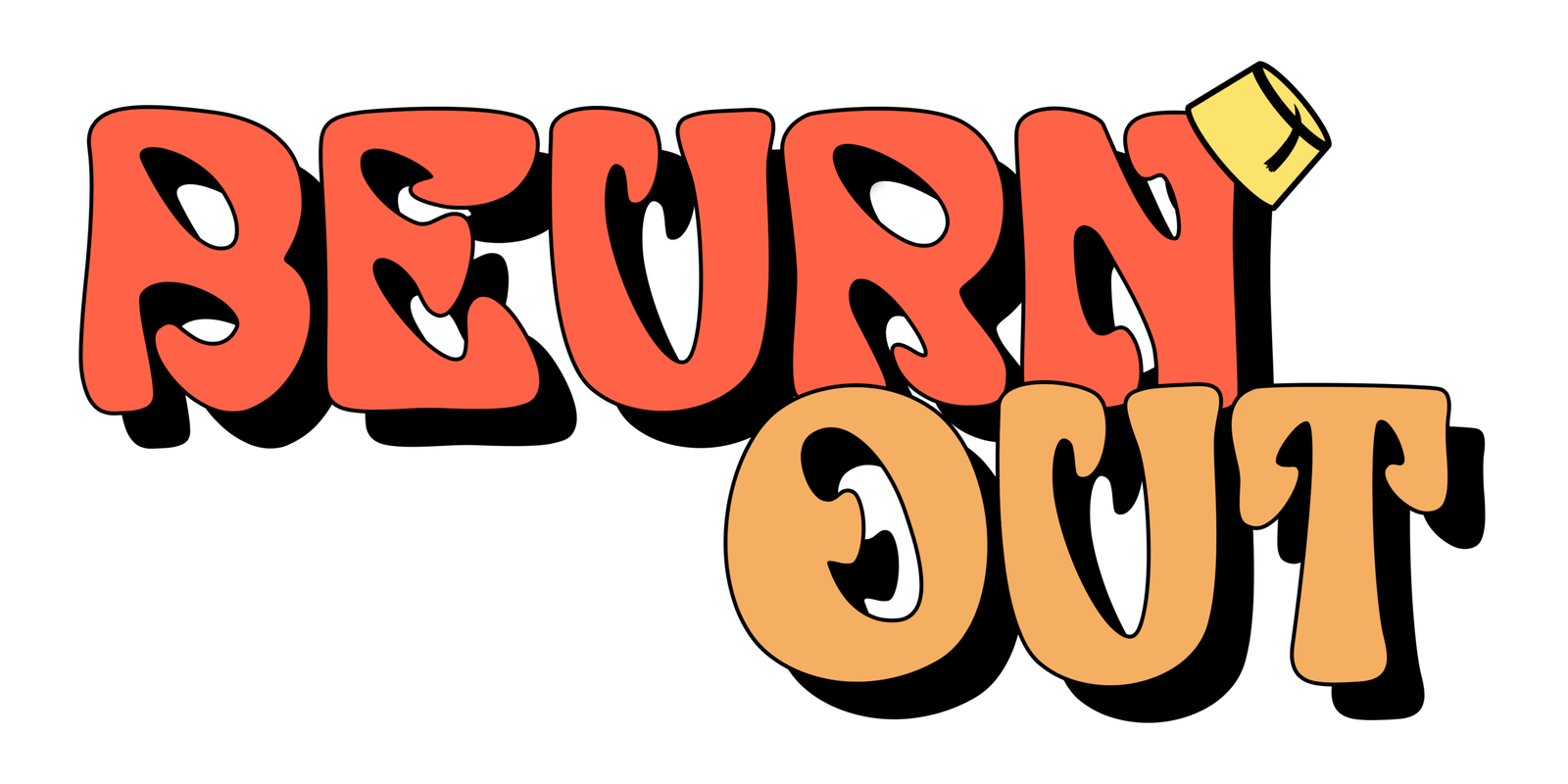


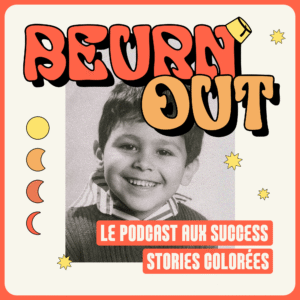
Une réponse
Bonjour. Pas toute à fait juste. Jusque dans les années 2000, taghazout était encore un village de surfers qui accueillait tout au long de l’année surfers du bout du monde et famille marocaines. Ces 15 à 20 dernières années ont connu une instagramisation alarmante de la petite ville qui reste néanmoins et par endroits encore authentique.