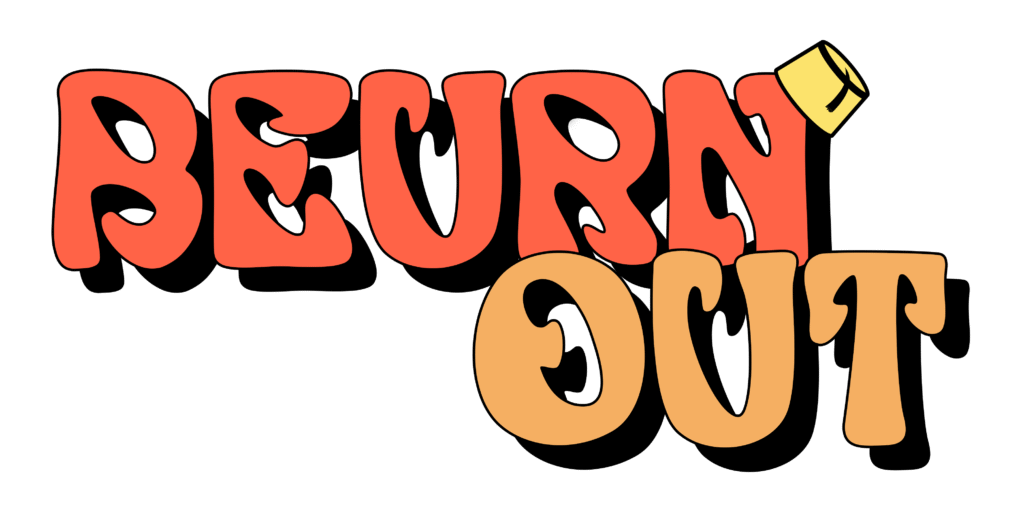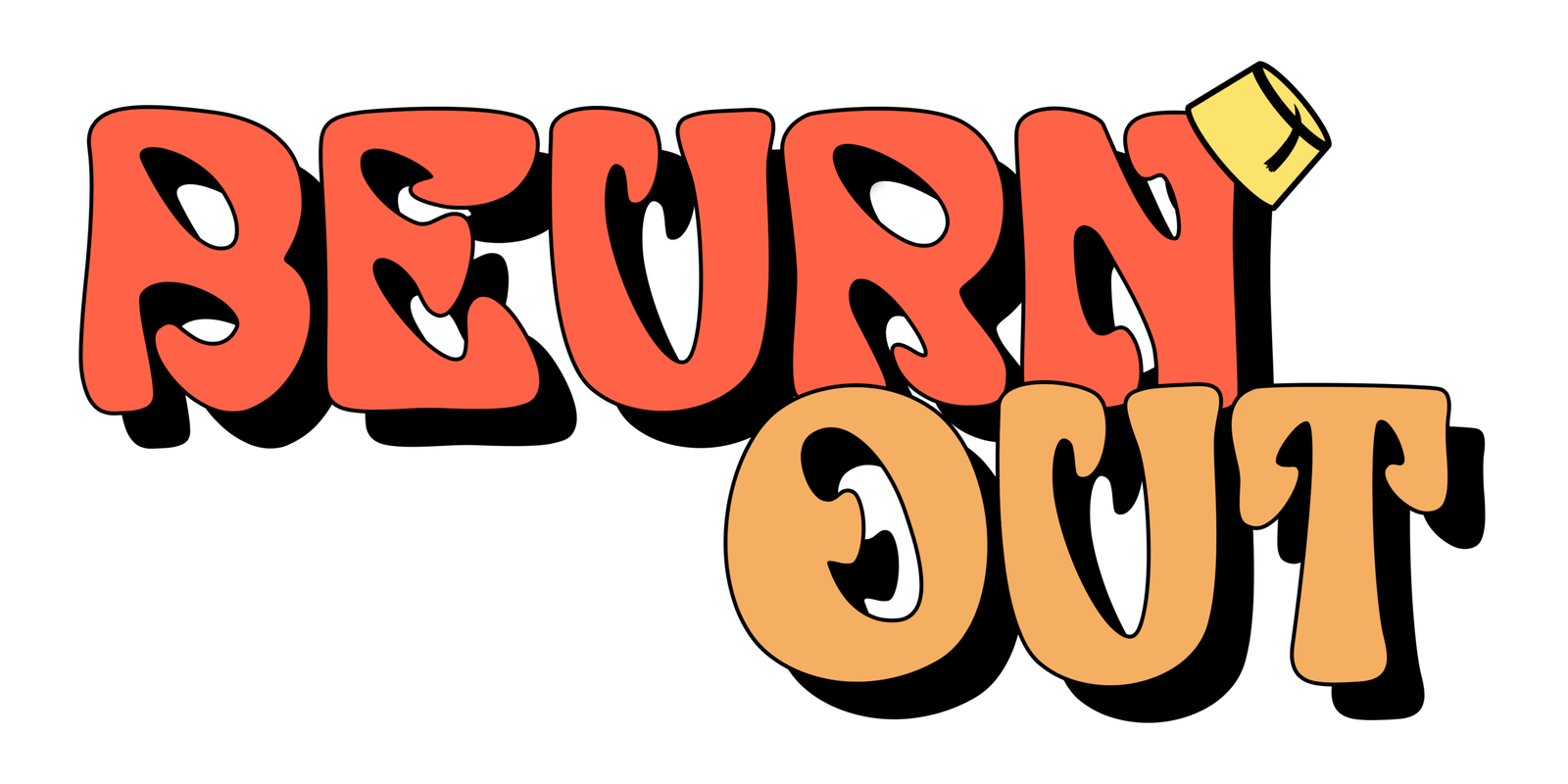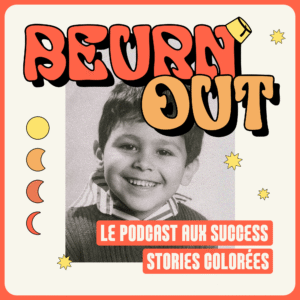Impossible de le nier, en quelques mois l’album BAD BOY LOVESTORY de la « Boss
Lady » Théodora et sa réédition MEGA BBL ont explosé les records et ont remis dans le
haut des charts, des genres musicaux marginalisés depuis des années.
Pendant que le rap français mainstream tourne en boucle entre trap, drill et égotrip, on voit
émerger une autre scène : plus colorée, plus dansante. Une génération d’artistes bouscule
les codes du rap hexagonal en apportant les sonorités de genres longtemps laissés en
coulisse : bouyon, kompa, shatta, zouk, dembow, amapiano… Des styles autrefois
invisibilisés, aujourd’hui ravivés par une génération prometteuse qui ose les mélanger, les
moderniser et les assumer pleinement.
Ces genres, pourtant, portent chacun un héritage riche. Le bouyon, né en Dominique dans
les années 1990, tient son nom du « bouillon » d’influences qu’il rassemble : musiques
traditionnelles, zouk, dancehall… C’est une musique pensée pour la danse, au rythme
rapide et aux basses puissantes. On peut aussi mentionner l’afrobeat, imaginé dans les
années 1970, qui mêle funk, jazz et percussions africaines avant de se réinventer en
version plus pop et électronique, aujourd’hui omniprésente dans les hits. Le kompa, né en
Haïti, déroule ses guitares, ses cuivres et ses rythmes syncopés, inspirant désormais la
pop urbaine et le zouk moderne. Plus récent, le shatta, hérité du dancehall et façonné aux
Antilles. Quant à l’amapiano, importé d’Afrique du Sud, il fusionne la house, le jazz et des
rythmes locaux qui invitent toujours à la même chose : la danse.
Citer tous les genres de musiques afro-caribéennes est une mission presque impossible
tant il en existe une multitude.
Mais alors, pourquoi pendant si longtemps n’en avons-nous pas entendu parler ? Peut-
être parce que les artistes se sont pliés aux exigences et aux conformités.
Peut-être pour s’assurer un succès rapide.
Pour toucher le plus large public, il fallait coller aux tendances américaines et sacrifier un
peu de son identité. Peut-être à cause des préjugés sur les danses qui les accompagnent,
souvent qualifiées à tort de trop sexuelles ou trop vulgaires.
Aujourd’hui, le paysage musical change. La scène et nos oreilles s’ouvrent à autre chose,
et le public, plus curieux, redécouvre des sons et des sonorités longtemps mis de côté.
Parmi les visages de ce renouveau, on trouve beaucoup d’artistes féminines. Des figures
populaires comme Yu Meï, Théodora, Meryl ou encore Maureen, prouvent qu’il existe bel
et bien une place sur le devant de la scène pour ces voix afro-caribéennes.
Meryl, Maureen et de tant d’autres artistes utilisent le créole dans leur musique et ce n’est
pas anodin.
Le créole utilise des sonorités qui manquent au français, c’est une poésie et il marque la
liberté, même s’il peut rester tabou. Leur succès montre qu’il n’y a plus de limite et que les
artistes peuvent aller au bout de leur création, en embrassant leurs racines.
Le bouyon, l’afrobeat, le kompa et les autres refont surface avec le sourire et surtout avec
le talent.
La preuve ? Théodora a récemment dépassé Céline Dion en grimpant sur la deuxième
marche du podium, de l’artiste féminine la plus streamée en 2025, derrière Aya Nakamura.
L’artiste, encore émergeante il y a quelques mois, a battu tous les records en se faisant
connaître sur les réseaux sociaux avec le morceau KONGOLESE SOUS BBL, un son de
bouyon. Elle n’ouvre pas la porte à une nouvelle ère musicale, elle la défonce.
Évidemment, n’oublions pas les artistes masculins qui, eux aussi, participent à faire
évoluer cette scène. Ni celles et ceux qui débutent et qui sont encore peu connus. Kalash
et Joé Dwet Filé (du côté afro/dancehall) sont de ceux qui ont préparé le terrain.
Aujourd’hui, ils cassent les codes et ouvrent la voie à des sons hybrides, plus libres.
Ce qu’on entend, c’est le reflet d’un métissage musical assumé, sans frontières. Les
artistes piochent dans leurs racines et mêlent tous les styles sans se limiter aux cases
toutes faites. Cette infusion de sonorités afro-caribéennes est désormais reconnue et
récompensée par la cérémonie Les Flammes, avec des catégories dédiées : « morceau de
musique africaine ou d’inspiration africaine » et « morceau de musique caribéenne ou
d’inspiration caribéenne ».
Les artistes ne se cachent plus et puisent leurs inspirations dans leurs origines, en
ignorant les remarques souvent racistes et/ou sexistes qui persistent. Un plaisir pour nos
oreilles et pour nos playlists qui ne demandent qu’à s’enrichir !
Romane Haye