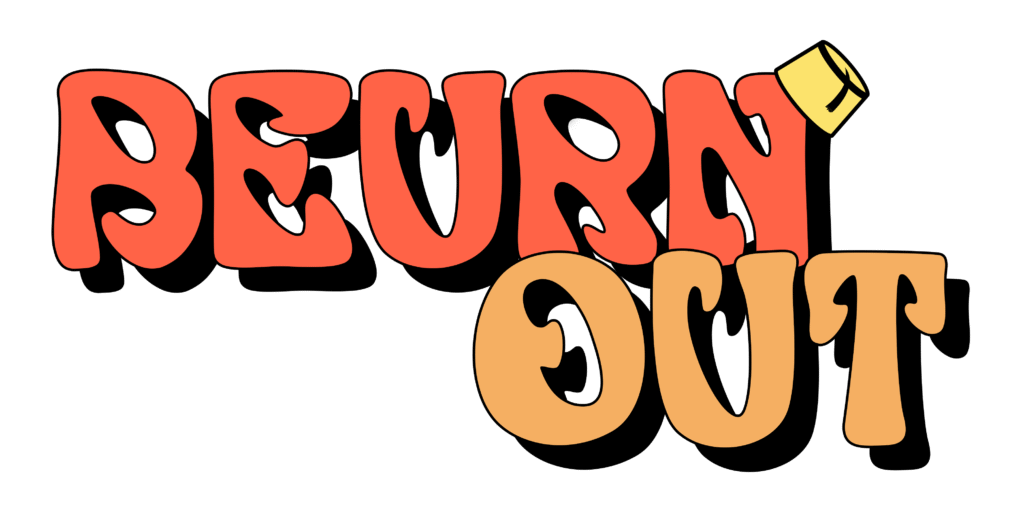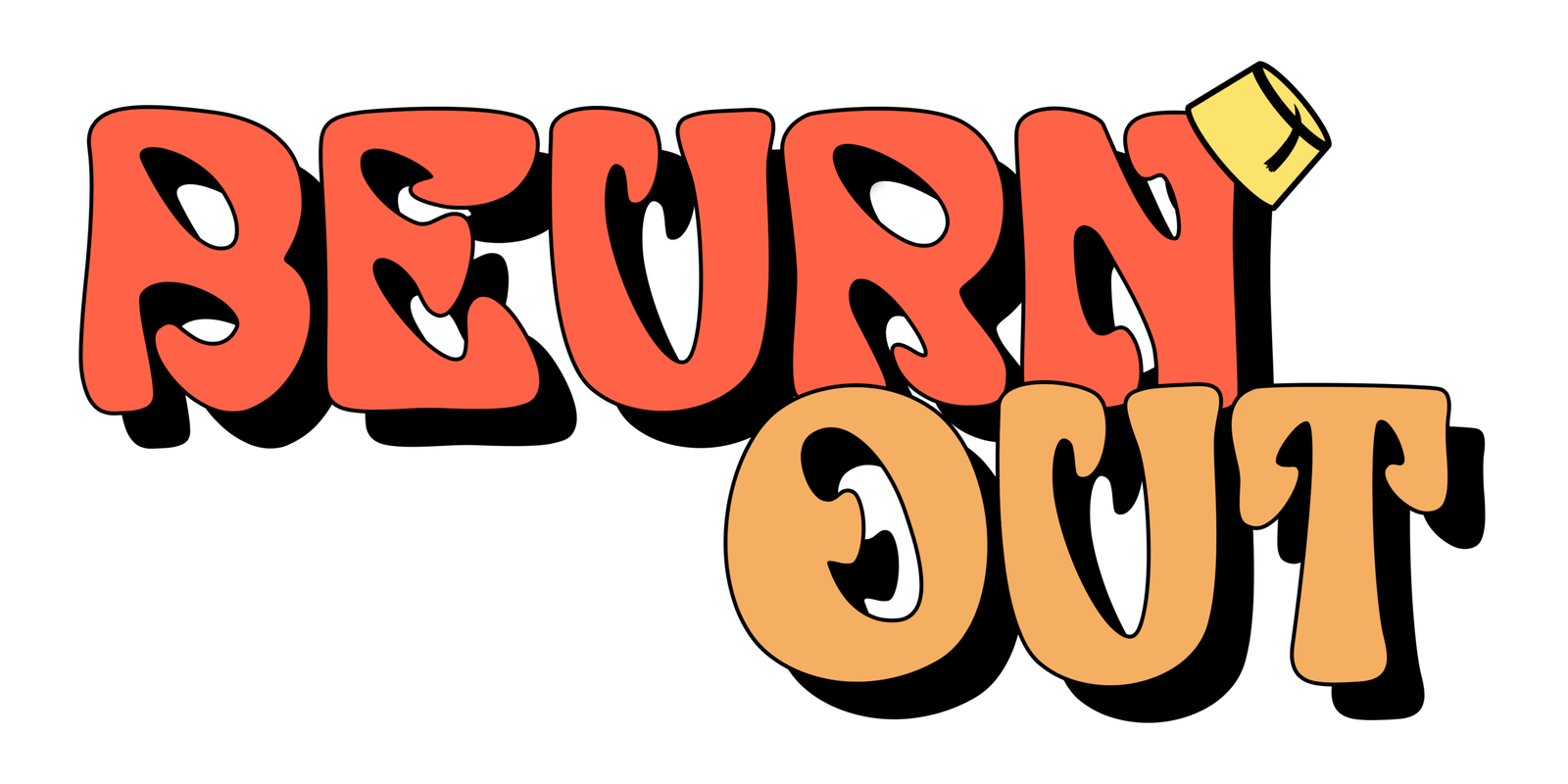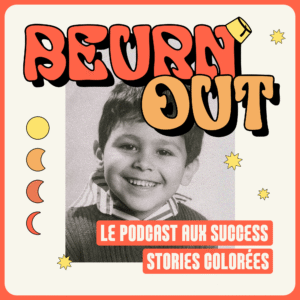C’est quoi la gentrification ?
Le mot “gentrification” vient de l’anglais “gentry”, qui désignait autrefois la petite noblesse. Inventé dans les années 1960 par la sociologue britannique Ruth Glass, il décrit un phénomène urbain : la transformation d’un quartier populaire par l’arrivée de populations plus aisées, qui entraîne une hausse des loyers et un changement de l’identité du quartier.
Concrètement ? Des cafés “bio”, des galeries d’art et des magasins de vêtements “éthiques” remplacent petit à petit les boucheries, kebabs ou cafés PMU. Les logements sont rénovés, les espaces verts fleurissent, mais les habitant·es d’origine, souvent des classes populaires, ne peuvent plus suivre et sont peu à peu poussés vers la périphérie.
Pourquoi certains disent que c’est “bien” ?
Sur le papier, la gentrification est présentée comme une revitalisation urbaine :
- Les logements sont rénovés.
- L’espace public est plus entretenu.
- Des commerces dits “de qualité” s’installent.
- Le quartier devient “plus sûr”, selon certains indicateurs.
Les pouvoirs publics y voient souvent une dynamique positive : hausse de la valeur foncière, nouvelle attractivité économique, meilleure “mixité sociale”… Bref, un quartier qui “monte”.
Mais cette vision cache une réalité bien plus brutale.
La face sombre de la gentrification
Derrière les façades ravalées et les brunchs à 18€, la gentrification agit comme une machine à exclusion sociale :
- Hausse des loyers : en moyenne, ils explosent dans les quartiers en cours de gentrification. Les familles modestes doivent partir, souvent sans avoir leur mot à dire.
- Expulsions invisibles : ce n’est pas toujours violent ou spectaculaire, mais c’est progressif et silencieux. On parle d’éviction économique.
- Perte d’identité : les commerces et les cultures locales sont remplacés par des standards “bobo” ou touristiques. Le lien social se fragilise.
- Pression psychologique : les habitant·es historiques se sentent dépossédé·es de leur propre quartier, parfois jugé·es comme “encombrants” par les nouveaux arrivants.
Pourquoi les classes populaires sont les plus touchées ?
Parce qu’elles n’ont pas les moyens de suivre l’inflation urbaine. La gentrification s’appuie sur une logique de marché : plus un quartier devient attractif, plus il devient cher. Mais dans un monde où les inégalités économiques explosent, ce sont toujours les mêmes qui payent le prix de “l’amélioration”.
Les quartiers populaires sont aussi ceux où vivent, en majorité, les personnes racisées, les travailleur·ses précaires, les familles monoparentales… La gentrification devient alors un révélateur des inégalités sociales, raciales et économiques.
Et si on pensait la ville autrement ?
La question n’est pas de refuser toute transformation urbaine. Mais de se demander pour qui on transforme la ville. Peut-on rénover sans expulser ? Investir sans exclure ? Favoriser la mixité sociale sans déguiser un nettoyage de classe ?
La gentrification est un symptôme. Celui d’un urbanisme dirigé par le capital, et non par les besoins des habitant·es. Il est temps de remettre le droit à la ville entre les mains de celles et ceux qui la vivent, la font, la rêvent.